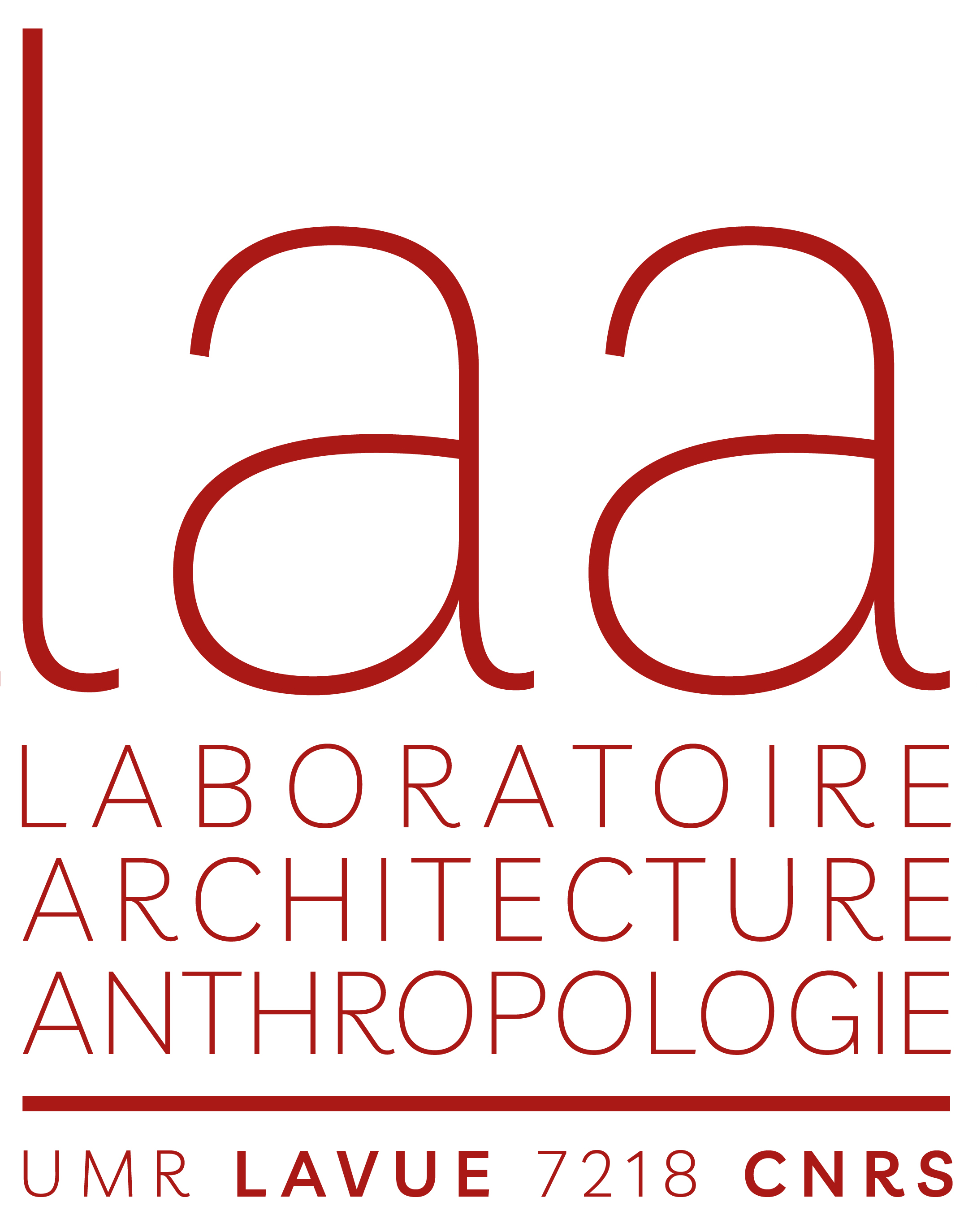Quelle est la fonction des controverses théoriques et académiques pour l’architecture ? Doit-on les comprendre comme des moments où les architectes font émerger de nouveaux thèmes et centres d’intérêts orientant leurs pratiques ? Ou bien comme un moment où se révèlent les enjeux qui saisissent leur champ ? La controverse, en tant que débat organisé mettant en jeu différentes visions du monde, engage toujours diverses formes de médiations entre la discipline et son extérieur : des publications, des conférences, des institutions, des projets pédagogiques, etc. Mécanisme de production de capital symbolique, culturel et social pour les protagonistes comme pour la discipline elle-même, elle permet aussi de définir un espace discursif où circulent tout un ensemble de projets, de concepts, de références et d’images. Nous avons souhaité (re)lire une controverse académique du début des années 2000 qui s’articule, au sein du monde académique anglo-saxon, autour de la place de la critique en architecture. Elle voit la constitution d’une position rapidement qualifiée de postcritique qui s’oppose à l’attitude intellectuelle héritée d’une philosophie continentale (poststructuralisme, marxisme, théorie critique de l’École de Francfort) qui, insatisfaite des conséquences du Mouvement Moderne et des errements du Style International, avait tenté dans les années 1960 d’engager l’architecture dans la quête d’une forme d’autonomie et de résistance face aux logiques de dominations économiques et culturelles à l’œuvre dans les sociétés occidentales. Mais, plutôt que de reprendre cette controverse dans une logique binaire d’opposition entre deux camps, nous proposons de retracer la discussion et les échanges séminaux qui la précèdent à travers les images qui y sont mobilisées. Dans ce but, nous avons mobilisé les outils de l’iconologie critique, une stratégie d’enquête et d’interprétation qui ne s’attache pas tant à décrypter les significations des images (visuelles, mentale ou textuelles) qu’à comprendre comment elles œuvrent dans un certain milieu, pour reprendre les mots de W. J. T. Michell. L’iconologie nous permet d’instaurer un point d’observation à partir duquel nous pouvons cartographier les mouvements de circulation des images, localiser leur provenance et suivre leur évolution en lieux et en temps. À partir des propositions formulées sur vingt ans par la tendance postcritique, nous dessinons trois constellations d’images voisines qui permettent de saisir autant de besognes dévolues aux images : elles permettent à la discipline de s’auto-représenter, de constituer une structure de valeurs et d’intérêts permettant de se rapporter au monde, et de penser des modalités d’interactions sensibles avec les architectures sur le mode de la fantasmagorie. À travers ces trois lignes d’exploration, le « postcritical debate » se présente à nous moins comme l’affrontement de deux positions clairement établies ou de deux générations de théoriciens et praticiens (une lecture souvent avancée par ses premiers commentateurs) que comme l’expression de transformations profondes (et des inquiétudes qu’elles suscitent) qui traversent la discipline architecturale au tournant du nouveau millénaire.
On s’intéresse alors à l’émergence des nouveaux outils de conception assisté par l’informatique, à la financiarisation de la fabrique de l’urbain, aux mutations des tâches et condition l’exercice des travailleurs de l’architecture dans un monde professionnel de plus en plus contraint, et aux imaginaires culturels et politiques qui s’expriment dans le champ architectural. Suivant images et concepts dans leur mouvement, nous tentons alors de comprendre comment ils sont mis au travail pour constituer des imaginaires qui nourrissent des projets, informent des réflexions théoriques et justifient de nouvelles pratiques de projet.