
Nous sommes à Tijuana depuis presque une semaine et on vient de changer notre plan initial, nous n’irons pas comme prévu jusqu’à Nogales dans le désert pour voir la construction du mur car cela impliquerait une autre recherche. Nous n’avons pas assez de temps. Déjà ici nous il est difficile de saisir la complexité des phénomènes urbains qui prennent lieu devant nos yeux.
C’est dimanche, nous décidons de nous rendre à « la Linea » qui signifie le poste douanier en argot local, et se trouve à l’embranchement entre Tijuana et San Ysidro. La séparation entre les deux pays et les deux espaces urbains porte de nombreuses appellations étant donnée l’orographie variable de la ville. Le mur est le nom octroyé à la double muraille construite par le gouvernement des Etats-Unis dans les années quatre-vingt–dix (au même temps qu’il signait un accord de libre échange avec le Mexique), mais ce même mur devient « el Bordo » lorsqu’il s’approche de la mer. Le nom de « la Linea » est ainsi donné aux postes douaniers qui se localisent dans le centre nord (San Ysidro) et nord-est (Otay).
Nous marchons à pied zigzaguant l’immense ligne de voitures qui font la queue pour passer « del otro lado ». Marcher à pied vers le poste douanier de San Ysidro n’est pas un choix très pratique, car il n’y a pas de la place prévue pour les piétons. Nous marchons donc sur la chaussé et par moments sur l’autoroute en s’approchant de la douane. La queue de voitures est longue de quelques kilomètres et la chaleur fait augmenter la pollution des voitures en marche. De nombreux vendeurs proposent leurs marchandises – de la nourriture, des souvenirs de Tijuana, ou du Mexique, tout forme d’artisanat. Nous esquivons les voitures. A un certain moment, une femme d’aspect mexicain, dans une grosse voiture nous demande en anglais si nous nous sommes perdus, et nous explique comment arriver à « la Linea ». C’est tellement rare que les gens marchent dans cette ville qu’il semble que nous sommes une espèce d’attraction – la dernière du week-end - pour les touristes de retour dans leur ville. Ou peut être c’est que nous avons tellement l’aire paumés sous le soleil que forcement nous réveillons des sentiments de compassion ou de rire.

A « la Linea » nous nous arrêtons sur un pont piéton depuis lequel nous dominons la scène. Sept longues files de voitures au soleil et la chaleur qui augmonte, de nombreux magasins de souvenirs se situent des deux côtés de notre panorama, au même temps qu’une ligne encore plus longue de personnes qui attendent leur tour pour passer par les check points piétons. Après le 11 septembre, lorsque les autorités des Etats-Unis ont endurci les contrôles des check points le temps d’attente s’est multiplié, les tijuanenses ont trouvé une ruse pour détourner ce temps d’attente. Les autorités douanières avaient laissé trois check points pour les personnes se déplaçant en vélo (souvent moins chargés que les autres). Cela a stimulé l’inventivité des commerçants mexicains qui se sont mis à louer – pour quelques dollars - des vélos dont le seul but est de faire la queue dans l’emplacement réservé aux cyclistes. Une fois passé, quelqu’un récupère le vélo de l’autre côté et se charge de le passer de retour. Si du côté américain les mesures de contrôle sont draconiennes, du côté mexicain souvent elles ne sont que le prétexte pour l’extorsion des immigrants. Le poste de contrôle s’applique seulement aux voitures, tandis que les personnes qui rentrent à pied, passent par des tourniquets.
Nous restons quelques minutes à enregistrer le son qu’ils produisent avec les passages de ceux qui entrent au Mexique, ce qui contraste avec le silence qui règne dans les grandes salles pleines de caméras dans le poste de contrôle américain. A l’intérieur tout est propre, calme, silencieux, on se croirait dans un aéroport. A l’extérieur tout est chaotique, bouillonnant, brouillant, mais c’est cette image est tellement cliché que nous ne le dirons plus.
Nous nous rendons à l’autre Linea, un studio d’architectes et d’artistes réunis autour de la figure de Marco Ramirez « Erre », un artiste plasticien et écrivain de Tijuana. Nous retrouvons là-bas Giacomo Castagnola, un architecte péruvien qui a accepté de discuter avec nous de sa vision de Tijuana. Nous nous intéressons à sa conception car il est en train de réfléchir sur la ville en pensant à Lima, la ville d’où il vient. Pour la première fois, nous parlons avec quelqu’un qui n’a pas une perspective de la ville centrée sur la frontière.
Qu’est-ce que c’est la frontière pour quelqu’un qui habite à Tijuana ?
Pour Rene Peralta, par exemple, elle est un élément constitutif de la ville, alors que pour Giacomo, la frontière n’existe pas, dans le sens qu’elle n’est pas un élément qui entre ni dans sa réflexion ni dans sa pratique professionnel. Cependant, son atelier se trouve là, juste au côté de « la Linea » de telle manière à ce que l’on croirait que l’un des ses murs est aussi celui du poste de contrôle. On est vraiment au point zéro du Mexique.
« La première fois que je suis venu dans la région, c’était à San Diego pour travailler dans un studio d’architecture. Je n’avais pas une idée de Tijuana, ni de la frontière. Je suis de Lima et tout ce qui se passe à Tijuana est plus familier que San Diego. Je peux vivre dans les deux côtés de la frontière mais, je préfère vivre ici. Je bouge ici, comme je le fais là-bas ; je marche dans les rues…. A San Diego, tout est comme stérile. Moi, je ne m’intéresse pas aux questions de la frontière. Je ne parle pas de la frontière. Je vis ici, je bosse ici, mais en réalité, je ne parle pas de ça ».

Giacomo habite Tijuana mais pense à Lima. Sa recherche se configure comme une sorte de registre, de classification de cette ville à partir de ce qu’il appelle « la mémoire matérielle des mutations urbaines » qui est liée aux comportements individuels. D’après lui on peut approcher la ville à partir des unités concrètes comme les individus qui peuvent devenir des unités urbaines à partir desquelles l’on peut observer le processus d’urbanisation comme un processus accumulatif. Les métaphores qu’il utilise dans son discours sont souvent d’ordre biologique, par exemple quand il parle des éléments qui constituent ce processus et qu’il décrit « …comme une matière qui est au même temps un mémoire qui contient des informations, comme pour le ADN ».
Pour montrer ça, il a produit des séries de photos sur les vendeurs des rues, sur les maisons auto construites, sur les personnes portant des panneaux publicitaires, sur les transports en commun, etc. Ces comportements individuels font la ville et son processus d’accumulation. La mémoire qu’ils expriment n’est pas de l’ordre de « la nostalgie », plutôt elle est un registre matériel des micromutations urbaines. « C’est quelque chose de mobile que se transforme en immobile »
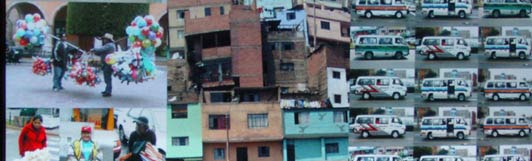
« On peut observer les mutations d’une ville à partir de micro accumulations. Une personne seule peut être considérée comme une unité de logement, une unité de travail, une unité de transport, une unité de vie. A différence du système gringo où tu peux accéder au crédit pour acheter ta maison, ici comme à Lima les gens envahissent un terrain seul ou avec des organisations. Tu fais ta propre invasion. Tu fais ta maison… parfois tu est ta maison. Les gens accumulent des objets, des biens, des matériels. Tu peux voir les différentes étapes dans leur évolution. C’est un processus dans le temps, n’est pas quelque chose de déterminée a priori, de planifiée. […] Cela n’est pas l’objet d’un projet urbain ou architectural. Ce un processus de croissance sans projet, par micro interventions ».
Cet éloge continue que Giacomo nous fait de la dimension « micro » s’appuie sur un élément très concrète et structurale de la réalité urbaine des villes latino-américaines : le manque d’argent, qui permet aux gens d’investir seulement des petit sommes dans leur maisons ou dans leur activité.
Même si sa pensée n’est pas tout à fait articulée, on ressent une nécessité chez Giacomo de se rattacher à des systèmes de pensée plus complexes. « Ce qui fait ces villes c’est l’informalité. Cette informalité est à la base de tout. Si tu vois Lima, Mexico, La Paz, ou n’importe quelle autre ville latino-américaine, ce qui constitue l’urbain est le phénomène de l’informalité. Tijuana est comme ça. J’essaie de voir ça et de le comprendre à partir d’un niveau, comme pourrons-nous le dire…micro cellulaire, des micro accumulations et micromutations. Je cherche à trouver la régularité en tout cela ».

