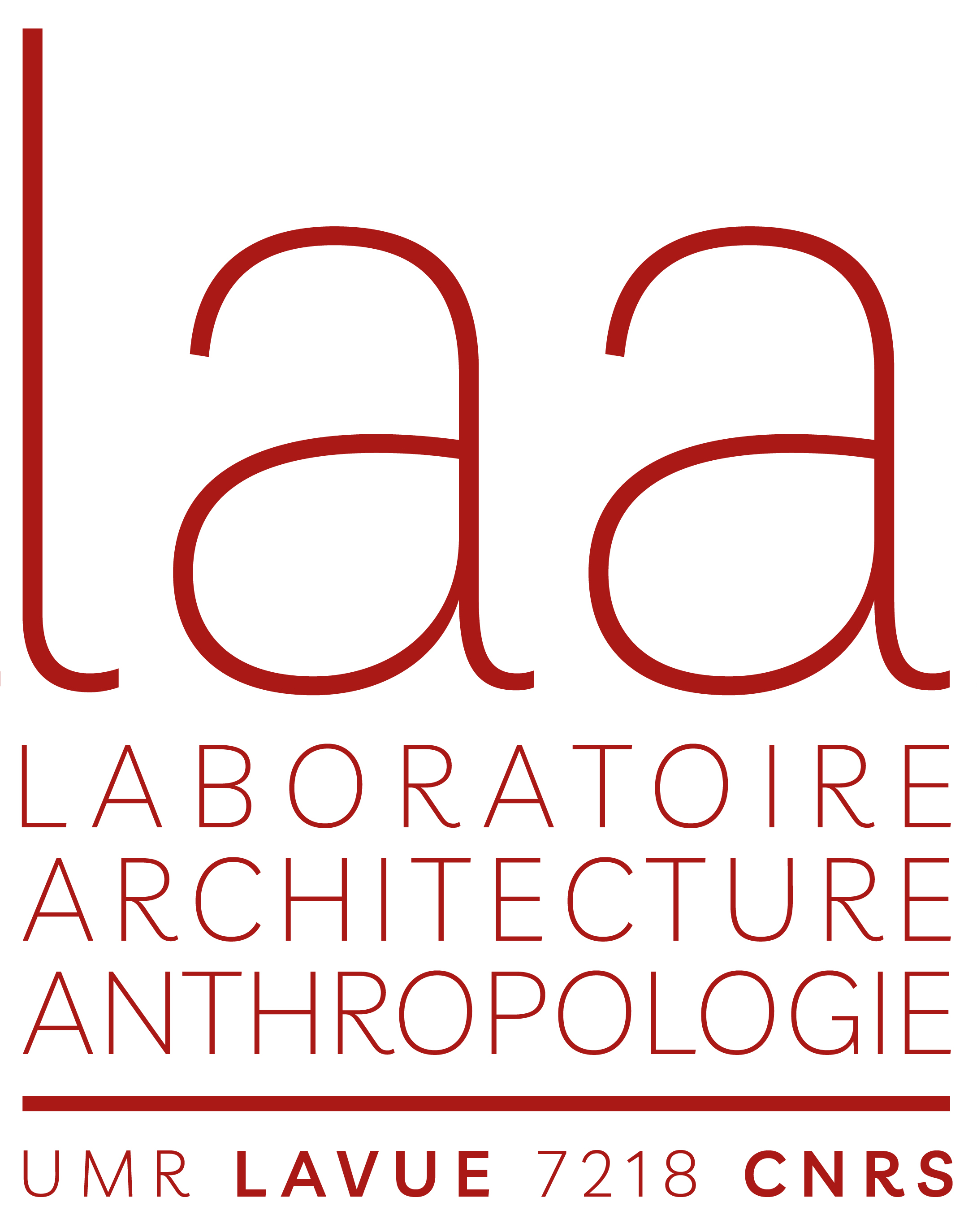La parution des cours de Deleuze Sur la peinture est récente. À leur lecture, on constatera que Deleuze emprunte un certain nombre de concepts à une discipline qui s’est donnée pour tâche de poser le cadre d’une logique de la sensation transcendantale : la science de l’art (« Kunstwissenschaft », qu’on ne confondra pas avec une histoire de l’art). Les concepts de cette science sont repris dans Francis Bacon et élevés au rang de catégories picturales par Deleuze : « haptique » , « tactile-optique », « optique », « manuel », et « chromatique ».
Riegl, Wölfflin et Worringer revendiquent l’influence commune d’un architecte allemand, celle de Gottfried Semper (1803-1879). Il est curieux que Deleuze n’évoque jamais cette influence (que ce soit dans ses cours Sur la peinture ou dans Francis Bacon). Il est pourtant difficile d’imaginer qu’il ne soit pas tombé sur le nom de Semper. Comment se fait-il que Deleuze l’ait passé sous silence, si « l’architecture est le premier des arts », comme il le dira dans Qu’est-ce que la philosophie ? Que nous apprend ce silence ? Telle est l’interrogation qui m’a porté à donner à mon projet de recherche la forme d’une étude comparative des visions de Semper et de Deleuze sur la polychromie. Il s’agit moins de documenter une lacune que d’en explorer l’occasion d’une problématisation.
Mon hypothèse de travail est la suivante : s’il est vrai que les propos de Semper sur la peinture semblent périphériques à l’égard de l’architecture, et que les énoncés de Deleuze sur l’architecture semblent marginaux dans son œuvre, il y a en réalité de bonnes raisons pour confronter leurs discours. Ils se répondent l’un à l’autre et se complètent, au prisme d’une posture commune : celle de l’arpenteur des surfaces.
Je voudrais démontrer que l’approche des surfaces polychromes propre à chacun instaure une grille de lecture des mécanismes de pouvoir et de domination. En architecture, Semper envisage la combinatoire des couleurs à partir de l’expression d’un principe d’identité sur une surface. Tandis que Deleuze concentre sa vision de la polychromie sur l’emploi des tons rompus. Entre la polychromie de Semper et celle de Deleuze, la différence passe entre les champs sémantiques de la bigarrure et du bariolage. Elle est déjà mise en avant par Platon (Philippe Jockey l’a bien montré dans Le mythe de la Grèce blanche) : tantôt la diversité est rapportée à une commune mesure (bigarrure), tantôt elle ne l’est pas, et demeure démesurée (bariolage). Grâce à un repérage chromatique, il devient ainsi possible de mettre en évidence l’instauration de rapports de forces dans les revêtements architecturaux.
Trouve-t-on, chez Semper et Deleuze, les germes d’une vie qui résiste au pouvoir, une vie qui serait l’envers d’un pouvoir prenant la vie pour objet, lisible à même le revêtement polychrome des édifices architecturaux ? Telle est la question centrale de mon travail en cours.