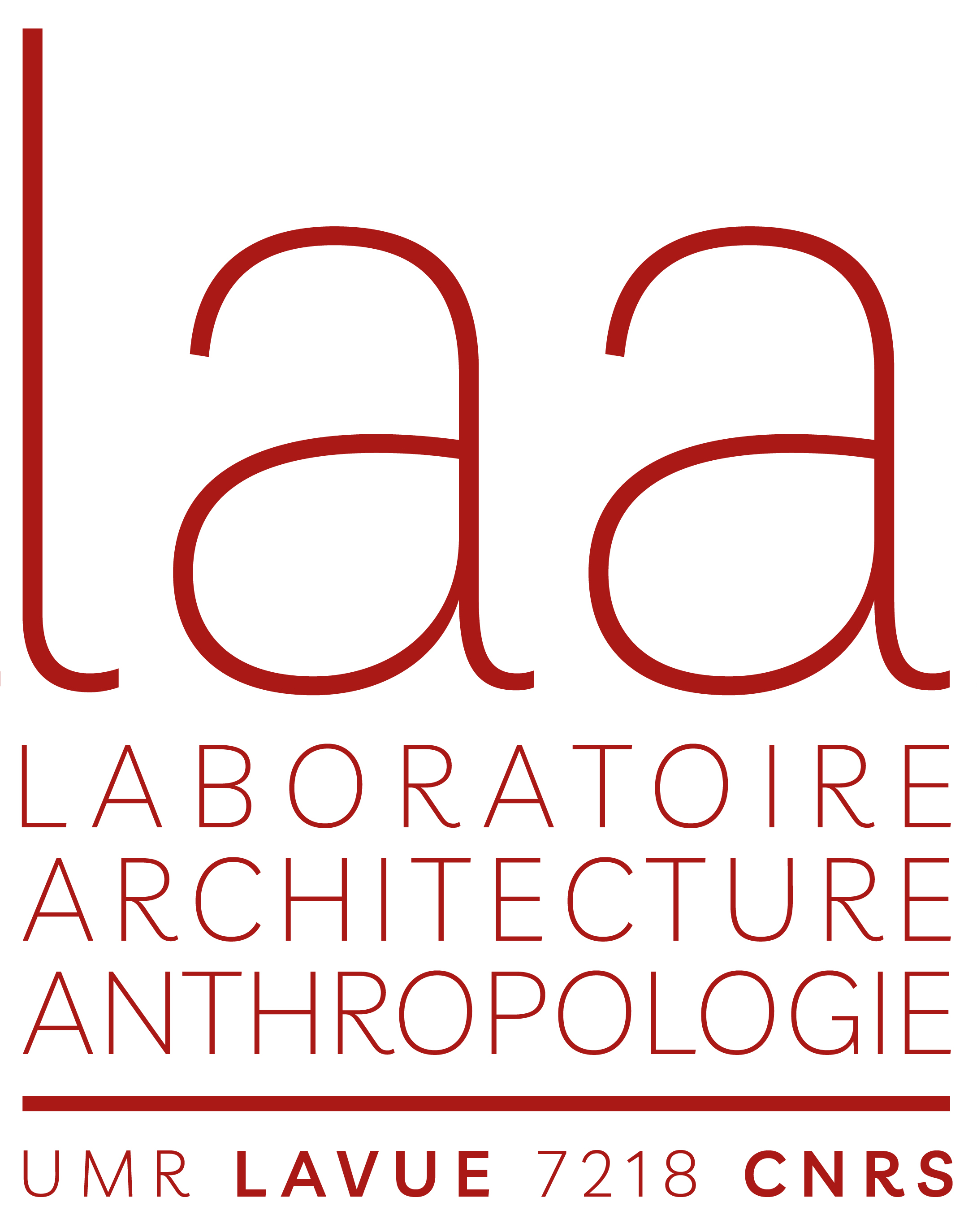Ferdinando Fava nous a quittés le 14 août 2025, à l’âge de 65 ans. Son absence se fait déjà cruellement sentir. Sa gentillesse, sa générosité, sa sympathie, la finesse de son regard, la rigueur de sa pensée et son écoute toujours sincère ont marqué des générations de jeunes anthropologues, mais aussi nous, ses collègues et ses amis.
Issu de l’école de Gérard Althabe, il réalisa son doctorat à l’EHESS entre 1998 et 2005, période où nos chemins se sont croisés. Ses recherches menées à Palerme, au cœur du quartier ZEN (Zona Espansione Nord), donnèrent naissance à une ethnographie remarquable, au centre de sa thèse. Ce travail devint un ouvrage marquant, Banlieue de Palerme. Une version sicilienne de l’exclusion urbaine, publié en France en 2007 puis en Italie en 2011.
Anthropologue urbain, Ferdinando s’est consacré à l’étude des marges sociales, explorant avec une rare sensibilité les réalités des quartiers populaires, des espaces périphériques et des populations invisibilisées. Ses enquêtes interrogeaient les dynamiques de précarité, de violence et de stigmatisation, mais aussi celles de résistance et de transformation sociale. Homme de terrain autant que de réflexion, il incarnait une anthropologie engagée, attentive aux voix des sans-voix (2007d).
Par son travail de longue haleine et son intérêt pour l’urbain, il a su instaurer un dialogue fécond et continu avec les disciplines de l’espace. Ce dialogue, parfois “bloquait” à cause de l’usage, pour lui trop superficiel, de certaines catégories comme « pratique » ou « appropriation », en donnant lieu à des malentendus qu’il s’efforçait inlassablement et pédagogiquement de démêler (2014a). Dès 2010, il s’intégra activement au Laboratoire Architecture Anthropologie (LAA-LAVUE, UMR 7218, CNRS) de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette, tout en contribuant aux écoles doctorales en architecture et urbanisme de plusieurs universités italiennes.
Avant sa titularisation à l’Université de Padoue, au département de Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, où il devint professeur d’anthropologie culturelle et urbaine, Ferdinando joua un rôle majeur dans ce qu’il appelait une « anthropologie appliquée ». Interrogeant sans relâche le « geste anthropologique » (2016b), il portait son savoir et ses outils aussi bien dans les universités que dans des formations professionnalisantes, en Italie comme en Europe. Visiting professor dans de nombreuses universités françaises, européennes et latino-américaines (France, Belgique, Pologne, Maroc, Albanie, Finlande, Autriche, Pays-Bas, Argentine, Colombie, Mexique, Brésil), il refusait l’idée de se fixer quelque part au risque d’exclure les marges. Par exemple en Argentine, il est intervenu dans des cours d’anthropologie avec des collaborations de recherche sur des sujets divers mais toujours abordés depuis une anthropologie du présent au présent. Dans un dialogue productif avec l’œuvre de Gérard Althabe, et en mobilisant une bibliothèque érudite forgée avec un esprit critique, Ferdinando a mené des recherches avec ses collègues argentins sur les immigrants italiens installés dans une petite ville de Buenos Aires (Université nationale du Centre de la province de Buenos Aires), sur le rôle de l’anthropologue italien José Imbelloni dans le développement de l’anthropologie argentine (Université Nationale de San Martin) et sur les conditions de vie dans les bidonvilles de Buenos Aires (Université pontificale Catholique d’Argentine).
Jusqu’en janvier dernier, il parcourait encore la péninsule et le monde pour participer aux débats académiques, former de jeunes chercheurs et tisser des liens. Son écoute active, jamais dominatrice, faisait de lui un chercheur généreux et un interlocuteur attentif, capable d’entrer en dialogue avec tous. À Padoue, ses qualités d’écoute et de dialogue le conduisirent rapidement à coordonner des programmes et des échanges internationaux, notamment dans le cadre de l’Erasmus Mundus Techniques, Patrimoines, Territoires de l’Industrie : Histoire, Valorisation, Didactique, en partenariat avec de nombreuses universités en Europe, en Afrique, en Amérique latine et au Japon. Entre la France et l’Italie, Ferdinando bâtissait des ponts, ouvrait des chemins et ne refusait jamais un engagement, même au prix d’un emploi du temps surchargé. Pendant près d’une décennie, parallèlement à ses activités académiques italiennes et internationales, il co-anima au LAA un axe de réflexion intitulé « Être habitant ? », nous interrogeant inlassablement sur cette catégorie si ambiguë.
En 2015, il publia un ouvrage nécessaire : Qui suis-je pour mes interlocuteurs ?. Cette question, « aussi habituelle qu’inattendue, souvent retenue au bord des lèvres », écrivait-il, révèlait la complexité de nos identités et de nos rapports quotidiens. L’ouvrage montrait comment cette interrogation transforme l’enquête anthropologique en dévoilant des dynamiques relationnelles échappant au contrôle du chercheur — ce que Gérard Althabe appelait « implication ». Ferdinando développa la notion de « lien émergent » comme clé d’une anthropologie réflexive et engagée. Ferdinando soulignait ainsi l’inversion radicale opérée dans la perspective anthropologique althabienne : au lieu de chercher la réponse à qui dois-je m’adresser ou comment dois-je me comporter pour interagir en tant que chercheur avec les personnes que je rencontre, il s’agit de comprendre qui suis-je en tant que chercheur pour mes interlocuteurs. A travers sa notion de « lien émergent », Ferdinando a pu rendre compte du processus par lequel il est possible d’appréhender les significations qui constituent la scène sociale. En considérant le lien social émergent comme un produit original de la recherche anthropologique, Ferdinando que la connaissance ne peut pas être réduite au seul statut d’information car la dimension éthique lui est constitutive.. D’où la pertinence de sa question fondamentale : qui suis-je pour vous, ici et maintenant ? Véritable plaidoyer pour une méthode vivante, le livre offrait des réponses contemporaines aux enjeux de réflexivité, d’éthique et de politique dans la recherche.
Parallèlement mais profondément entrelacée à cette question est sa réflexion sur la pédagogie et tout particulièrement celle sur l’enseignement de l’anthropologie. Sur la place, encore une fois, que l’enseignant doit avoir mais surtout celle qu’on doit donner à l’apprenant·e. Dans un article récent (2024), il proposait une analyse brillante de l’opposition, pour lui stérile, entre enseignement à distance et enseignement en présence. Plutôt que de nourrir cette dichotomie, il invitait à recentrer la réflexion sur l’essentiel : placer les étudiant·es au cœur du processus d’apprentissage, en repensant les pratiques pédagogiques pour les rendre dynamiques, engageantes et collaboratives, quel que soit le format. Encore une fois, il ramenait au premier plan, avec une clarté déconcertante, des questions fondamentales souvent éclipsées par les préoccupations professorales.
Ces dernières années, Ferdinando s’était aussi engagé dans son village natal, Fontevivo, près de Parme, aux côtés d’un collectif citoyen “Fontevivo Comitato per l’Ambiente”, pour empêcher l’implantation d’un pôle logistique d’e-commerce, totalement disproportionné pour le territoire. En tant que chercheur et citoyen, il porta une action concrètement engagée, proposant en même temps une lecture anthropologique des transformations territoriales à travers leur dimension imaginaire et iconique. Il montrait comment l’image même de ce projet condensait une tension entre un univers social « virtuel » — celui de la valorisation territoriale promise — et le monde « réel » qu’il prétendait transformer. Cette lutte, pour l’instant victorieuse contre une multinationale puissante, fut pour lui l’occasion d’exprimer, aux côtés de ses concitoyens, un engagement civique et politique profond.
Avant d’être anthropologue, Ferdinando avait été géologue. De cette première formation, il avait gardé une méthode singulière : « goûter les pierres » pour les comprendre. En anthropologie, il avait transposé ce geste — à chaque rencontre, il nous « goûtait », pour mieux nous saisir dans notre singularité.
Ferdinando, tu nous·me manques déjà.