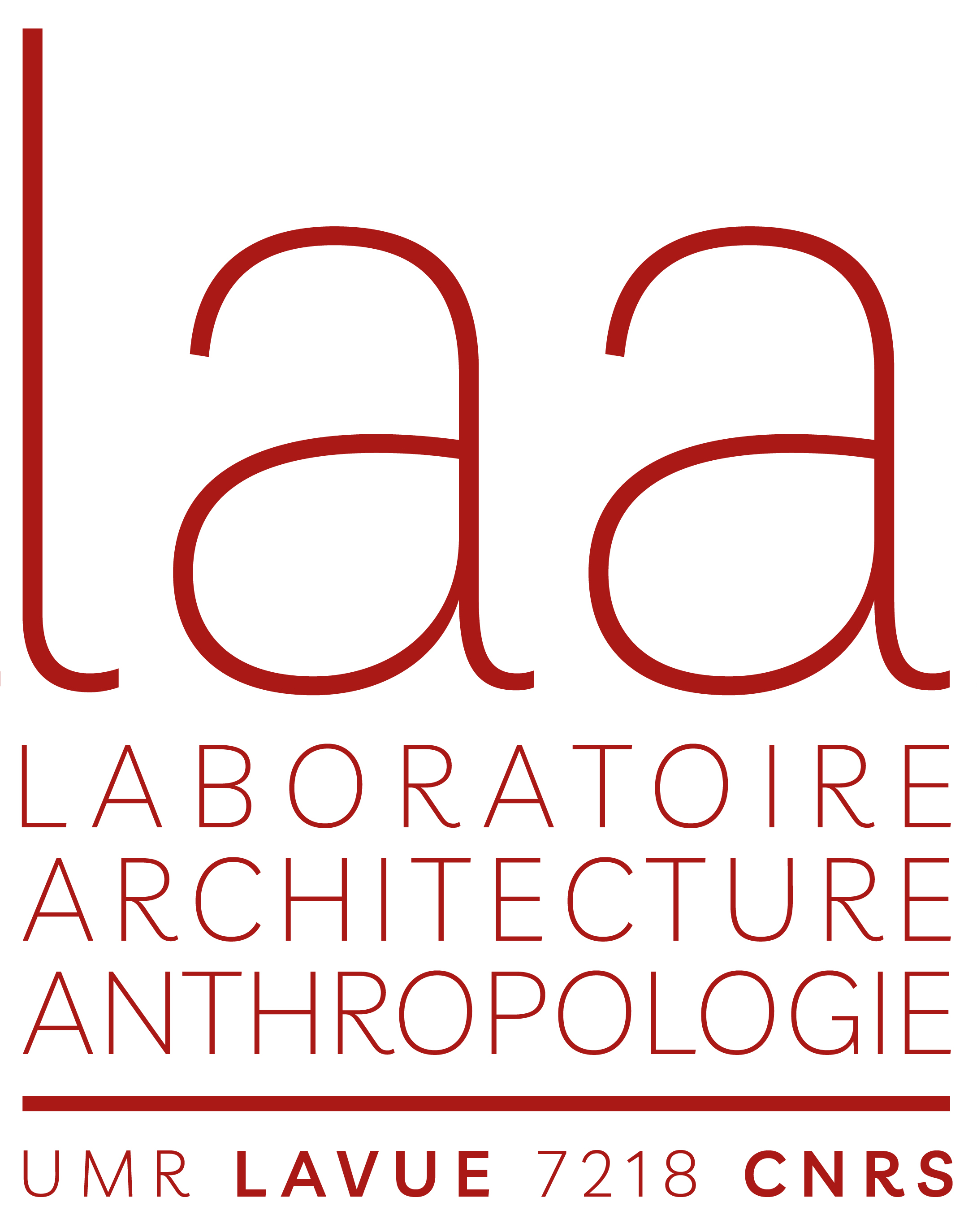Cette étude établit une distance critique vis-à-vis du discours conventionnel sur la conception biomimétique en examinant minutieusement les mécanismes de traduction par lesquels les modèles biologiques se transforment en applications architecturales. Dépassant les récits célébratoires de la biomimétique, cette recherche interroge les fondements épistémologiques d’un domaine qui se présente souvent comme objectif malgré sa dépendance à des processus interprétatifs intrinsèquement subjectifs.
Par une déconstruction méthodique d’études de cas sélectionnées, cette investigation révèle des écarts significatifs entre les modèles biologiques et leurs manifestations architecturales—écarts qui émergent non pas simplement comme des limitations techniques mais comme des distorsions systématiques intégrées dans le processus de traduction lui-même. La recherche démontre comment les formations disciplinaires des concepteurs, leurs cadres culturels, leurs positions socioéconomiques et leurs biais cognitifs déterminent fondamentalement quels aspects des systèmes biologiques sont privilégiés, lesquels sont négligés, et comment ils sont ensuite abstraits et recontextualisés.
Cette analyse codifie des schémas spécifiques de biais : la simplification réductive des systèmes biologiques complexes ; le biais de confirmation qui souligne sélectivement les caractéristiques biologiques s’alignant avec des objectifs de conception prédéterminés ; la fixation morphologique qui privilégie les formes visibles au détriment des processus ; et la myopie disciplinaire qui interprète les phénomènes biologiques à travers des prismes professionnels étroits. Ces biais ne sont pas fortuits mais constituent des composantes structurelles de la traduction biomimétique qui demeurent largement non reconnues dans les fondements théoriques du domaine.
En exposant méthodiquement l’écart entre l’inspiration biologique et l’implémentation architecturale, cette étude remet en question les prétentions de la biomimétique à une dérivation directe de la nature. L’article soutient que reconnaître ces dimensions interprétatives ne diminue pas la biomimétique, mais renforce plutôt la rigueur méthodologique en favorisant une conscience critique de soi. Cette perspective critique fournit une base pour des pratiques biomimétiques plus transparentes qui naviguent consciemment dans la subjectivité inhérente à la traduction entre les systèmes naturels et conçus, ouvrant de nouvelles voies pour des approches transdisciplinaires véritablement innovantes.